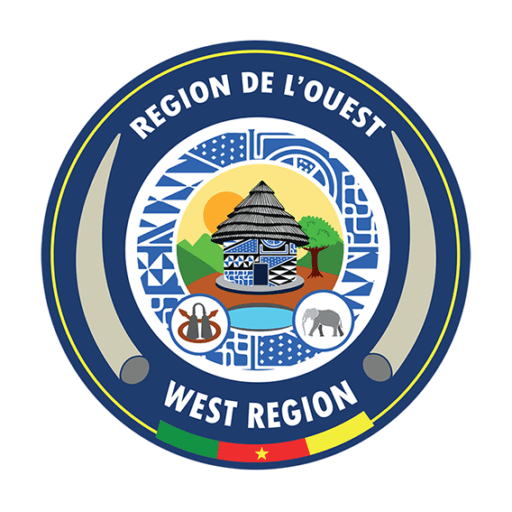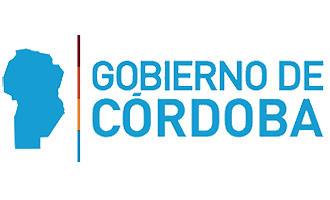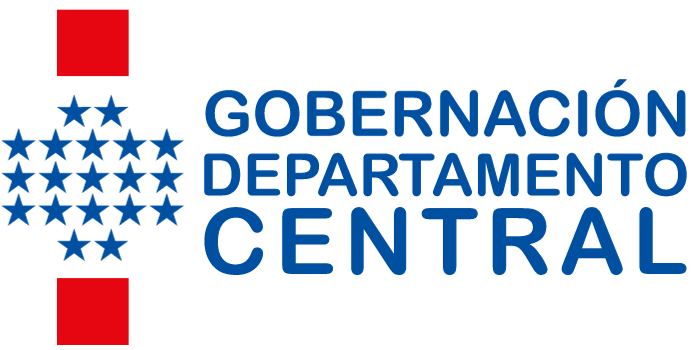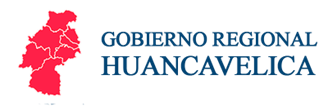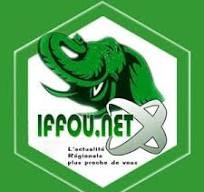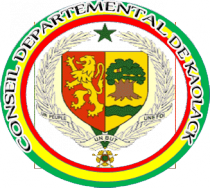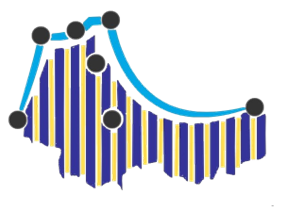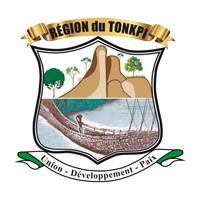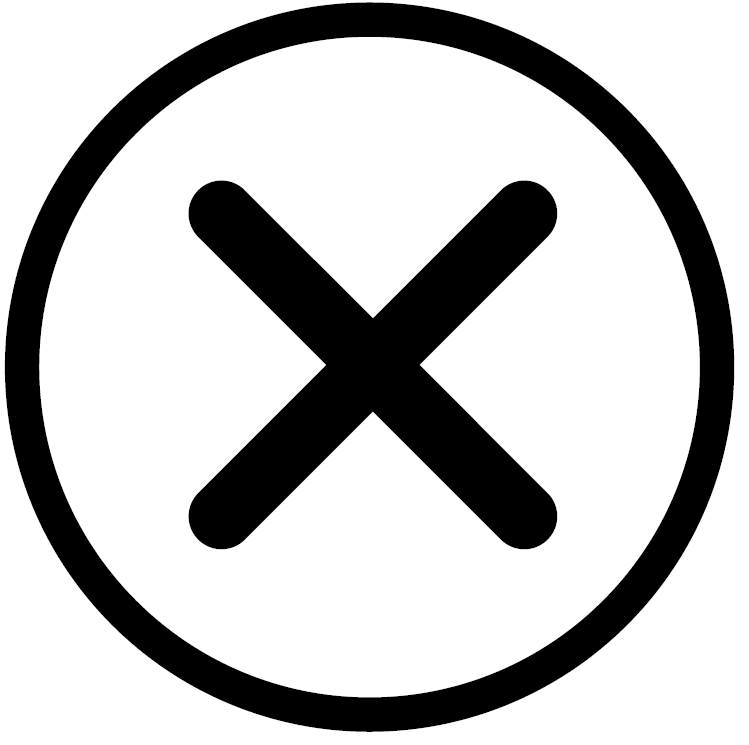Qu’est-ce que la cogouvernance?

Alain Jordà
Expert en Développement Territorial pour les villes, les régions et les pays
Auteur du livre “Développement Local et Territorial : un guide pour les Politiques et les Techniciens”
La COVID nous a montré que seules les collaborations à tous les niveaux – entre pays, entre les différents acteurs d’une société, etc. – nous permettent de surmonter les grands défis et les grandes menaces auxquels nous devons constamment faire face. La cogouvernance est l’idée que les administrations publiques, les municipalités et les régions, qui jusqu’à présent définissaient, décidaient et mettaient en œuvre les projets de manière autonome et indépendante de leur société locale, changent de rôle.
Dans la cogouvernance, le rôle des municipalités et des gouvernements régionaux est de diriger leur société. Mais, pour les grands sujets, les plus importants, et surtout pour ceux qu’ils ne peuvent pas mettre en œuvre seuls – qui, par ailleurs, sont la majorité (pensons, par exemple, aux changements dans la mobilité, à la gestion des déchets, à la gestion de l’eau, ou encore à la promotion du tourisme, ainsi qu’à de nombreux autres sujets qui dépendent des actions quotidiennes et de l’engagement de chaque citoyen et de chaque institution) –, le rôle des autorités publiques est de rassembler les citoyens pour chercher ensemble des solutions, faire des propositions et décider, collectivement, du chemin à suivre. Et c’est précisément cela, la cogouvernance.
La vertu de la cogouvernance réside dans sa capacité à réussir là où une participation mal conçue échoue lamentablement : avec une bonne cogouvernance en place, les citoyens ne se contentent pas de participer à la définition du chemin à suivre, mais, surtout, ils s’engagent à faire leur part du travail afin que la décision adoptée soit un succès.
Ainsi, la cogouvernance apporte deux valeurs essentielles à la gestion de la ville:
1. Tout d’abord, les solutions et les projets adoptés conjointement sont bien meilleurs que ceux que la municipalité ou la région pourrait concevoir seule (cette affirmation inclut également les cas où des experts seraient engagés pour concevoir le projet en question). En effet, la société regorge également d’experts dans chaque domaine, et les citoyens eux-mêmes possèdent une excellente connaissance de proximité de leur ville, de leur quartier ou de leur rue, ainsi que de ce qui s’y passe. Cela leur permet de fournir des informations précieuses pour perfectionner n’importe quel projet.
2. Lorsque les citoyens sentent que leurs contributions sont écoutées (et non simplement entendues) et qu’ils ont l’occasion d’exprimer leur opinion et de débattre des propositions des autres, ils s’approprient le projet construit collectivement. Cela se produit même si la proposition finale n’incorpore pas leurs contributions, car au cours du débat, chaque personne a pu défendre ses idées tout en écoutant des arguments raisonnables contraires ou des propositions encore meilleures que les siennes.
Un point supplémentaire très important : lorsque nous parlons de « citoyens », cela ne se limite pas uniquement aux individus et à leurs regroupements (associations, clubs, etc.), mais inclut également les universités et les entreprises. Obtenir le soutien des universités et des entreprises pour mettre en œuvre des projets locaux, dans un contexte d'insuffisance permanente de ressources qui caractérise les administrations locales et régionales, est le meilleur moyen d’augmenter les ressources disponibles pour la réalisation des projets urbains.
Un autre atout majeur généré par la cogouvernance est sa capacité à unir les forces des universités, des entreprises et de la société civile avec celles de l’institution publique en quête de ressources externes: qu’il s’agisse de soutien du gouvernement national ou de fonds multilatéraux, la cogouvernance améliore considérablement les chances pour le territorire d’obtenir ces ressources.
Engager les citoyens, produire de meilleurs projets et mobiliser le soutien des universités, des entreprises et de la société civile pour réaliser ces projets représentent un résultat extraordinaire pour tout gestionnaire local ou régional. Et pour cela, la cogouvernance est la solution. C’est pourquoi elle se développe progressivement, dans tous les types de gouvernements et dans tous les pays.
Comment mettre en œuvre la cogouvernance ?
On peut choisir de commencer, étape par étape, avec un sujet concret, puis d’élargir progressivement à d’autres domaines. Cependant, je suis convaincu que la voie la plus rapide et naturelle consiste à commencer par définir l’avenir du territoire de manière conjointe avec la société. C’est précisément ce que nous faisons dans les processus stratégiques menés avec les villes et les régions avec lesquelles je collabore.
La méthode par laquelle les villes et les territoires définissent leur Plan d’Avenir avec mon accompagnement est un pur exercice de cogouvernance. De plus, elle met en œuvre la cogouvernance de manière naturelle, de sorte qu’ils continuent à l’appliquer par la suite à de nombreux autres sujets de gouvernance dans ce territoire.
Différents scénarios pour la cogouvernance
La cogouvernance n’est pas seulement applicable dans un territoire ayant sa propre autorité locale; elle peut également être mise en œuvre dans d’autres contextes tels que:
Au sein d’une région, entre ses provinces
La cogouvernance entre les provinces qui composent une région leur permet de co-définir la trajectoire à suivre pour la région, de manière à ce que toutes les provinces se sentent partie prenante de l’effort régional, car leurs propres intérêts sont reflétés dans les plans régionaux.
Dans une intercommunalité, de régions ou de villes
Dans ce contexte, la cogouvernance est le seul moyen d’obtenir des résultats, car dans une intercommunalité, chaque membre est indépendant et autonome dans ses décisions.
L'intercommunalité prend tout son sens lorsque la collaboration entre ses membres s’oriente vers des préoccupations et des objectifs communs, que les membres estiment pouvoir aborder avec plus de succès en coopération.
Une cintercommunalité ne vise pas à avoir une influence sur l’ensemble des domaines de gouvernance de ses membres, mais uniquement sur les objectifs que ses membres définissent comme communs. La manière de définir les plans pour atteindre ces objectifs communs doit obligatoirement passer par la cogouvernance. Sinon, cela ne fonctionnera pas, car tout membre qui ne se sent pas pris en compte ne contribuera pas aux projets, même s’ils ont été approuvés par la communauté.
Dans le cadre de l'intercommunalité, la cogouvernance est donc la règle à suivre pour garantir le succès. C’est pourquoi le directeur ou la directrice de la communauté devra avoir d’excellentes compétences relationnelles pour travailler avec les différents maires ou gouverneurs.
Ci-dessous, vous trouverez un article sur un cas concret avec lequel j’ai travaillé il y a quelques années.
Quelques notes supplémentaires sur la cogouvernance
La cogouvernance ne se limite pas à la co-définition d’un plan ou d’un projet et au déploiement partagé des actions décidées conjointement. Elle inclut également un suivi commun de la mise en œuvre des plans ou des projets co-conçus. En ce sens, la cogouvernance repose sur deux aspects complémentaires et indissociables :
1. Du côté du leader, une délégation de la capacité de décision à l’ensemble de la société.
2. Une coresponsabilité dans l’exécution des projets et dans leur évaluation finale. En d’autres termes, toutes les parties sont responsables du résultat obtenu pour chaque projet. En cas de résultats insuffisants, elles se soutiennent mutuellement, soit pour améliorer ces résultats, soit pour assumer les erreurs afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent à l’avenir.
La cogouvernance intègre nécessairement la notion de débat. La co-définition de projets ou de plans n’est authentique que si elle s’appuie sur un débat. Présenter des projets préalablement définis pour validation ou pour des ajustements mineurs par la communauté ne relève pas de la cogouvernance. De même, la collecte d’informations par des enquêtes, des entretiens ou des assemblées, suivie de la synthèse en une proposition finale par une tierce partie, ne constitue pas de la cogouvernance. Celle-ci implique de poser un défi (par exemple, définir la vision future de la ville ou concevoir une rue pacifiée), de partir de zéro et de construire, étape par étape, avec les participants, une position commune en réponse au défi. Ce résultat ne peut être atteint que par le débat. Une méthodologie adéquate devra être utilisée pour encadrer chaque détail du processus, mais ce n’est qu’à travers des discussions argumentées et un consensus final autour d’une position partagée que les bénéfices de l’engagement collectif envers cette solution définie ensemble seront obtenus.
La nécessité d’un accord par le débat représente une formidable opportunité pour que de nombreux processus de co-définition deviennent de véritables générateurs d’innovation sociale ou territoriale, créant des solutions qu’il serait impossible d’imaginer sans ce processus d’échange entre des parties aux points de vue différents.
La cogouvernance ne dépend pas de lois ou de règlements. C’est l’autorité locale suprême qui peut rendre possibles les processus de cogouvernance sur son territoire, aussi bien s’il existe des dispositions législatives ou réglementaires en ce sens ou pas. Promouvoir la cogouvernance dans un territoire n’est pas une question de législation, mais de volonté et de leadership de la part de l’autorité locale.
La cogouvernance nécessite un processus d’apprentissage au sein de la société locale. Si bien l’autorité locale doit initier et promouvoir ce processus, la société locale doit également être sensibilisée pour comprendre la portée et les implications de la cogouvernance, ainsi que pour s’intégrer aux nouvelles dynamiques relationnelles qu’elle implique. En particulier, dans le cadre de la cogouvernance, les relations ne se limitent plus à “moi, la société, je demande au gouvernement de répondre à mes besoins” mais la cogouvernance introduit également la notion d’interdépendance et de coresponsabilité.
(Extrait de l’article «Participation vs. Cogouvernance»)