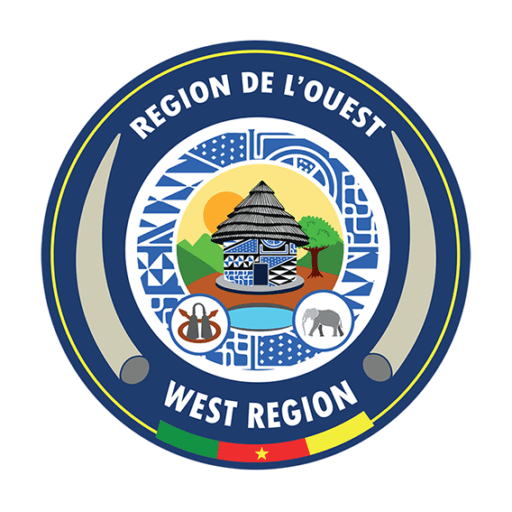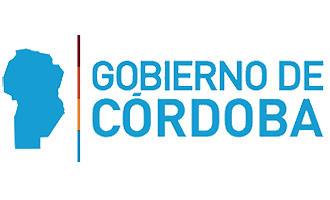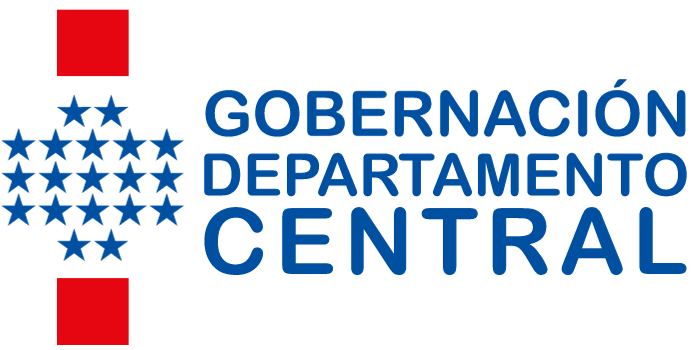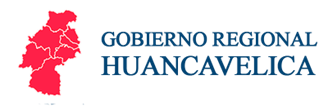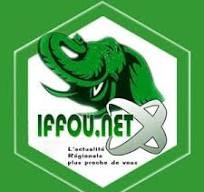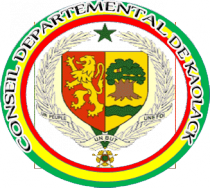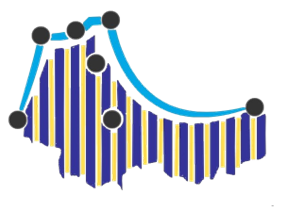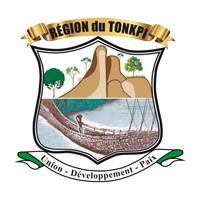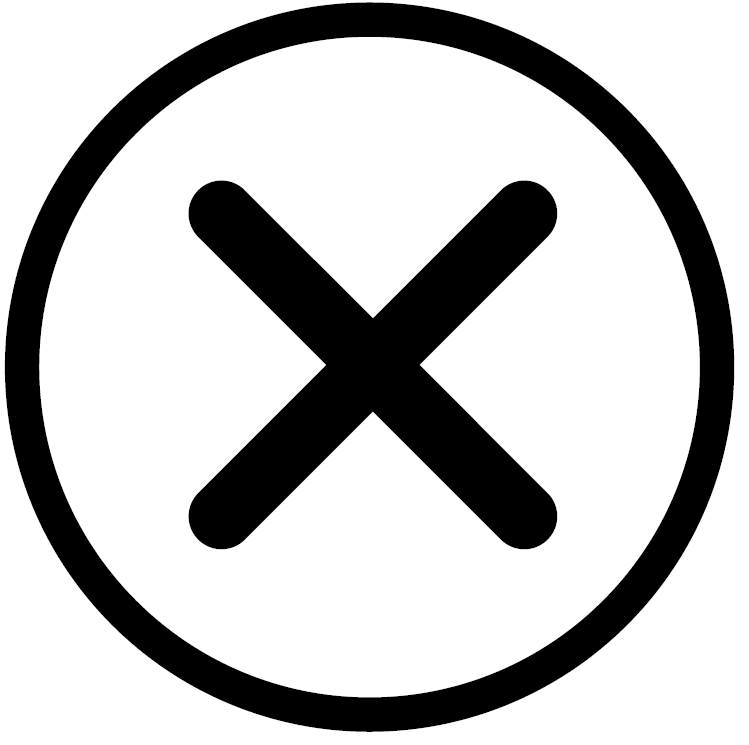Migrations, droits humaines et perspective de genre : un impératif politique

Claudia Martínez
Coordinatrice du Groupe de travail sur l'égalité des genres de l'ORU Fogar
Parler de migration, c’est parler de vies, de trajectoires, de projets collectifs et individuels mis en mouvement à la recherche de dignité et d’avenir. Les personnes migrantes ne sont pas des chiffres ni des flux ; ils ne sont pas des marchandises à commander, importer ou exporter. Ce sont des femmes, des hommes et des diversités qui traversent les frontières en emportant avec eux des histoires, des affections, des savoirs et des droits que doivent être reconnus et garantis.
La mobilité humaine constitue l’un des grands processus sociaux de notre époque, étroitement lié aux inégalités structurelles, aux crises environnementales, aux violences et aux conflits armés. Cependant elle exprime également la capacité des peuples à résister, se réinventer et de projeter nouvelles formes de communauté. Dans cet encadrement, il est inadmissible de réduire l’immigration à un problème de sécurité ou de gestion démographique. La seule façon légitime de l’aborder est à travers la reconnaissance en entière des droits humains, des ceux qui migrent.
Facteurs d’expulsion liés au genre
Il est essentiel de reconnaître que l’inégalité de genre agit comme un moteur d’expulsion même avant que la migration ne commence. Les femmes et les diversités habituellement sont les plus affectés par la dégradation environnementale et le changement climatique, ce qui, dans de nombreux contextes ruraux se traduit par une charge de travail plus importante dans le domaine des soins et un accès réduit aux ressources productives. La violence domestique et communautaire, avec les restrictions à la participation politique et économique, pousse des milliards de personnes à quitter leur foyer à la recherche des endroits plus sûrs. La manque d’opportunités éducatives et professionnelles, spécialement dans les sociétés où persiste une forte division sexuelle du travail, limite leurs horizons et transforme la migration en une stratégie de survie et de projet de vie. Cette chaîne d’inégalité dit en clair que la vulnérabilité liée au genre accompagne les personnes migrantes depuis leur lieu d’origine jusqu’à leur destination.
La perspective de genre comme obligation, et pas comme débat
Dans ce contexte, affirmer que les politiques migratoires doivent incorporer une perspective de genre ne peut pas continuer à être envisage comme un horizon désirable, ou comme une proposition en discussion. Aujourd’hui c’est une obligation politique et éthique. Les femmes et les diversités migrantes affrontent des violences spécifiques en partant par l’exploitation de travail et la violence sexuel jusqu’à la discrimination institutionnelle dans les pays de destination. Ces violences ne sont pas de faites isolés : ils sont l’expression des systèmes structurales qui reproduisent l’inégalité.
Reconnaître cette réalité exige que les États assument la responsabilité de designer des politiques qui non seulement protègent, mais garantissent également l'égalité d'accès aux droits dans des conditions dignes. Faire peser sur les épaules des femmes et des filles la responsabilité de la résilience est une injustice supplémentaire : ce fardeau ne doit pas leur incomber, mais plutôt aux États et aux institutions politiques qui doivent répondre à ces besoins avec engagement, ressources et détermination.
Intersectionnalité : reconnaître les inégalités multiples
Il n'existe pas une seule expérience d'être une femme migrante. Une femme autochtone qui migre d'une zone rurale est confrontée à des défis différents de ceux d'une femme urbaine de classe moyenne ; une personne transgenre migrante est exposée à des violences spécifiques qui combinent la discrimination fondée sur le genre, l'orientation sexuelle et l'origine. La migration ne peut être analysée ni légiférée d'un point de vue homogène : elle exige des politiques qui tiennent compte de l'intersection entre le genre, la classe sociale, l'origine ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle et le statut migratoire. L'intersectionnalité est donc un outil indispensable pour concevoir des réponses plus justes et plus efficaces.
De bonnes pratiques qui éclairent la voie
Dans ce cadre, certaines expériences concrètes montrent qu'il est possible d'adopter une autre approche en matière de politique migratoire. Le Secrétariat de la Femme de la rovince de Córdoba (Argentine) a créé un service d'aide intégrale aux femmes migrantes et à leurs familles, un espace pionnier qui reconnaît les femmes migrantes comme des sujets de droits et des protagonistes de leur propre histoire. Ce service s'inscrit dans le cadre d'une politique d'État qui reflète l'engagement soutenu de Córdoba en faveur de l'inclusion et de la garantie des droits. Parmi ses principales lignes d'action, on peut citer l'accompagnement dans les démarches administratives et les processus d'établissement, l'accès aux rendez-vous médicaux et aux contrôles de santé, les formations et les espaces de formation destinés à promouvoir l'autonomie et l'intégration, ainsi que les activités récréatives et culturelles qui renforcent la construction de réseaux communautaires. Par ailleurs, ce domaine encourage les tables rondes interinstitutionnelles avec des organismes internationaux et de défense des droits humains et internationaux, développe des formations dans des espaces universitaires et accompagne les femmes dans les processus de retour dans leur pays d'origine, en coordination avec les consulats, ainsi que les femmes argentines de retour de l'étranger.
Ce type de politiques sont des lueurs d'espoir qui marquent un horizon de possibilités. Elles démontrent que les migrations peuvent s'accompagner de solidarité, de justice et d'égalité, et que les gouvernements régionaux et locaux ont un rôle clé à jouer pour transformer la rhétorique en politiques concrètes.
Appel à l’action
Au sein du Groupe pour l'Égalité des Genres de l'ORU Fogar, nous soutenons que la migration ne peut plus être envisagée sous l'angle du contrôle ou de la gestion démographique. Elle doit être abordée sous l'angle des droits humains, de l'égalité des genres, de la justice sociale et de l'intersectionnalité.
Nous convoquons aux gouvernements régionaux et locaux à :
- Placer les droites au cœur des politiques migratoires, en reconnaissant les personnes migrantes comme des êtres humaines dignes de respect et non comme des chiffres dans une statistique.
- Intégrer obligatoirement la perspective de genre dans toutes les instances : diagnostics, conception, mise en œuvre et évaluation des politiques.
- Concevoir des politiques avec une approche intersectionnelle, en reconnaissant que les identités se croisent et produisent des inégalités différenciées.
- Rendre visibles et multiplier les bonnes pratiques existantes, telles que l'expérience de Cordoba, qui ouvrent la voie à l'inclusion et à la reconnaissance.
- Promouvoir des espaces de participation active où les femmes et les diversités migrantes peuvent jouer un rôle protagoniste dans les décisions qui affectent leur vie.
La migration n’est pas un problème à résoudre, c’est une réalité humaine qui interpelle nos responsabilités les plus profondes. Si nous voulons des sociétés plus justes, plus égalitaires et plus inclusives, nous devons commencer par reconnaître que toute personne qui migre a le droit inaliénable de vivre avec dignité. Garantir ce droit est, aujourd'hui plus que jamais, un impératif politique et éthique qui ne souffre aucun retard.
La garantie de ces droits n'est pas seulement la responsabilité des États, mais aussi celle des communautés, des entreprises et de chaque individu qui coexiste dans les sociétés d'accueil. La véritable intégration se construit dans la solidarité quotidienne.